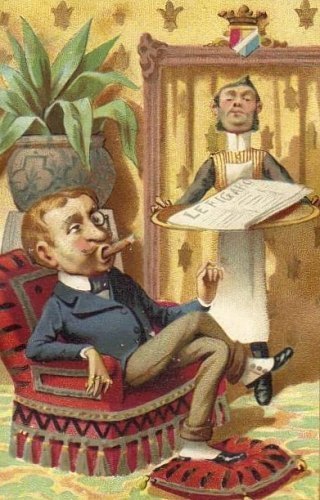
Il y a presque autant de types de journaux que de journaux, observe Le Goffic : le journal du soir « à manchettes », que les camelots crient par les rues, n’a rien à voir avec le grave journal doctrinaire qui paraît presque à la même heure, et celui-ci n’a que des rapports éloignés avec le journal « boulevardier » du matin qui tire à douze pages, lequel devrait être distingué à son tour du journal « populaire », du journal « mondain », du journal « d’informations », du journal « éclectique », etc.
Blancs ou rouges, conservateurs, progressistes, radicaux, socialistes, antisémites, catholiques, protestants et autres, l’auteur y dit leur fait à tous les journaux sans distinction. Et il les nomme en toutes lettres, et il nomme leurs rédacteurs, leurs directeurs et leurs administrateurs mêmement ; il parle d’eux comme s’ils appartenaient déjà au passé, avec l’indépendance et la tranquillité d’esprit d’un historien.
L’auteur y apparaît une fois de plus ce qu’il a toujours été, je veux dire une âme droite, une intelligence singulièrement déliée et pénétrante, un écrivain clair, substantiel et précis. Le livre de M. Fonsegrive s’ouvre par un chapitre très documenté et très fin sur l’évolution historique du journalisme. La presse a pris tant d’importance en ces dernières années, son rôle est si considérable dans les pays de liberté comme le nôtre, qu’il n’est point surprenant qu’on s’inquiète un peu partout des origines de cette puissance insoupçonnée des anciens et si redoutée des modernes.
Déjà Victor Le Clerc, Eugène Hatin et l’abbé Reure au milieu du siècle dernier, plus près de nous Gustave Le Poitevin et Eugène Dubief, en deux livres excellents, Aulard, dans sa chaire de la Sorbonne, et Henri Hauser, à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand, avaient quelque peu débrouillé la question. Nous savions par eux que la presse n’est point née en France, que l’Italie posséda des journaux dès qu’il y eut une imprimerie et qu’avant même qu’il y eût une imprimerie, les Romains eurent les leurs, sous forme de lettres et de placards qu’on se passait de main en main.
A l’autre extrémité du monde, en Chine, un journal existait il y a plus de mille ans déjà. C’était une sorte de journal officiel appelé le Kin-Pan, qui paraît toujours d’ailleurs et qu’on peut justement tenir pour le doyen des journaux du monde entier. Jusqu’à l’année 1301 de notre ère, le Kin-Pan ne paraissait que tous les mois et se bornait a enregistrer les événements les plus mémorables de la cour de Pékin. Devenu hebdomadaire, le Kin-Pan fournit une nouvelle carrière jusqu’en 1830, époque où il devint quotidien. Ce n’était point son dernier avatar : de progrès en progrès, le Kin-Pan a fini par tirer trois éditions par jour, la première qui paraît le matin sur papier jaune, la seconde à midi sur papier blanc, la troisième le soir sur papier gris. Le public, grâce à ce changement de couleur, ne saurait être trompé par des camelots peu scrupuleux.
Nos journaux français sont loin d’avoir des origines aussi vénérables que le Kin-Pan. Leur véritable ancêtre fut le « cri ». On appelait ainsi la proclamation faite en public, par un crieur patenté, des édits royaux, règlements de police, mariages de princes, naissances, guerres, traités de paix et autres événements notables que le roi voulait porter à la connaissance de ses sujets. Un arrêt du 13 avril 1468 établissait de la sorte la procédure à suivre pour le « cri » : « C’est la forme et manière de faire les cris ès carrefours de Paris (...) Le crieur dira : Or, oyez, de par le Roi, notre sire, et de par M. le Prévôt de Paris, et après que le peuple sera assemblé, ledit crieur dira : On vous fait assavoir de par le Roi, notre sire. »
Chose curieuse, la découverte de l’imprimerie ne fit pas disparaître le « cri ». C’est que, suivant la judicieuse remarque de Hauser, une invention nouvelle laisse toujours subsister pendant un temps assez long les procédés qu’elle a rendus inutiles. Tout le changement fut que le crieur, au lieu de lire les ordonnances ou les nouvelles officielles sur un placard manuscrit, les lut sur un placard imprimé. La grande supériorité de ce placard sur l’ancien, c’est qu’on pouvait le tirer à un nombre infini d’exemplaires et l’afficher, après lecture, à la porte des églises et des marchés. « Mais le placard, dit Hauser, était encore un procédé d’information bien imparfait. Seuls pouvaient le lire ceux-là qui, ce jour-là, étaient venus au marché. Ils l’apprenaient par cœur, plus ou moins bien, pour aller le redire chez eux ; mais ils ne pouvaient emporter dans leur mémoire que quelques faits précis, secs et nus. C’était le sommaire d’un journal ; ce n’était encore ni la chronique ni le reportage. »
On trouva mieux : l’in-octavo, un in-octavo léger, maniable, propre à lire en chemin et à fourrer dans sa poche. Les imprimés de cette sorte abondent dans nos collections publiques. Le premier en date est un petit livret de quatorze feuillets, imprimé en 1480, et que nous devons tenir, jusqu’à plus ample informé, pour le doyen des journaux français, Il a pour titre : Prologue de l’entrée du roi faite à Rouen en noble arroi, et l’auteur, un certain Pinel, y décrit successivement les arcs de triomphe, les estrades ornées de devises morales, tout l’appareil de ce grand événement. C’est du reportage avant la lettre. Pinel, à ce point de vue, est un ancêtre. Il a créé un genre. Aussi les imitateurs ne lui manquèrent-ils point. Le reportage des fêtes publiques, entrées de roi, sacres, funérailles, etc., devint à la mode, fit fureur dans toutes nos grandes villes de France.
Le fait est qu’on se perd dans toutes ces pièces qui nous décrivent minutieusement, en vers et en prose, les obsèques de « très excellente et très débonnaire » reine de France, Anne de Bretagne, le « devis des histoires » pour l’entrée du roi à Vienne en 1490 ou celui des pompes qui accompagnèrent l’arrivée dans Paris de Philippe le Beau, « archiduc d’Autriche, comte de Flandre et, entre ses autres titres, prince de Castille et d’Espagne ».
Fastidieux grimoires. Que ne les laissait-on sous leur poudre ? Patience ! De ces lourds inventaires de funérailles et de sacres, vous allez voir sortir quelque chose de plus sérieux, le reportage politique. En 1494 commencent les guerres d’Italie et, cette même année, paraît « la noble et excellente entrée du roi notre sire en la ville de Florence ». Encore une entrée de roi, direz-vous. Oui, mais entre une entrée à Lyon, à Valence ou à Toulouse et une entrée à Florence vous voudrez bien considérer qu’il y a quelque marge.
Par une rapide « évolution du genre », l’information politique va se détacher du récit des cérémonies officielles. L’année suivante, on communique au public « plusieurs nouvelles envoyées de Naples par le roi à M. de Bourbon, ensemble d’autres nouvelles ». Notez ces derniers mots : « C’est la première fois, dit Hauser, qu’on réunit sous une même brochure des informations diverses, c’est déjà presque le journal. Le jour où parut, on ne sait où, cette petite plaquette de six feuillets, la presse d’information politique était née. »
Le gouvernement prenait soin, la plupart du temps, de rédiger lui-même ou de faire rédiger par des gazetiers à sa dévotion des plaquettes d’informations politiques où les événements déniaient au jour le jour. Victoires, défaites, prises de villes, traités de paix, déclarations de guerre, tout y passait. On donnait tour à tour l’état de « l’armée du roi contre les Vénitiens », la délibération sur l’entreprise des Anglais et des Suisses ou le récit de « la prise et défaite des Anglais par les Bretons devant la ville de Bafileur ».
Les plaquettes se vendaient à la foire du Lendit ou aux foires de Lyon, de Beaucaire, etc. les colporteurs en faisaient provision et les répandaient de village en village. On voit par là combien Eugène Hatin s’est mépris en pensant qu’avant 1789 le pays demeurait absolument étranger à ce que nous appelons la politique extérieure : s’il avait montre l’indifférence qu’on lui prête, ses gouvernants eussent-ils pris tant de soin de le renseigner, par la voie des placards et des pièces votantes, sur les grands événements qui se passaient au dehors ? Il y avait donc déjà une opinion publique en France, puisque le roi s’occupait de la renseigner. Et, s’il se préoccupait tant de la renseigner, c’est donc qu’il était tenu déjà de compter avec elle.
Sous tutelle durant le premier Empire, elle reprit ses coudées franches sous la Restauration et le gouvernement de Juillet. « C’est peut-être a cette époque, remarque justement Fonsegrive, que les journaux ont été les échos les plus fidèles de l’opinion. Chacun d’eux prenait son mot d’ordre auprès des chefs de parti ; le journal dépendait du parti qu’il représentait. Il avait besoin de ses abonnés et ses abonnés l’auraient eu vite abandonné, s’ils n’avaient trouvé dans ses colonnes les échos de leurs rancunes ou de leurs aspirations. »
Tout changea avec Emile de Girardin. On sait que le fondateur de La Presse (1836) partait de cette idée, intéressante en soi, qu’un journal doit vivre de sa vie propre, avec ses ressources personnelles et donc ne plus rien demander au gouvernement ou aux partis. « L’écrivain libre dans te journal libre » fut la devise de Girardin. Et la devise était belle, mais elle était impraticable. Girardin réussit peut-être à émanciper la presse au point de vue politique, mais ce fut pour lui imposer une autre servitude et beaucoup plus dure. Les ressources dont il devait vivre, le journal fut obligé de les demander au commerce et à la spéculation : hier, il était une chaire ou une tribune du jour au lendemain, il ne fut plus qu’une « boutique ».
Comment, dès lors, se fier au journal ? s’interroge Le Goffic. Eh ! justement, réplique Fonsegrive, voilà le danger. Le lecteur d’un journal est trop porté à penser comme ce journal. Or, dans un quotidien de 63 900 lignes, savez-vous ce qui se glisse moyennement de réclames intéressées, tant avouées que déguisées ? De Noussanne en a fait le calcul : exactement 17585 lignes, soit 27,5% du total. Fonsegrive cite même tel quotidien où, de l’article leader à la signature du gérant, il n’y a pour ainsi dire pas une ligne qui n’ait acquitté à la caisse un droit de péage.
Mais enfin les quotidiens de cette sorte se comptent. Dans la plupart des journaux, l’article est l’expression de la pensée du rédacteur ou tout au moins du directeur qui l’inspire. Nouveau danger, dit Fonsegrive, car un journaliste, si grand qu’il soit et quelquefois peut-être à cause de sa grandeur, de son originalité d’esprit, de son talent de style, est loin d’être infaillible partout et toujours. Il a ses passions, ses partis pris, ses préjugés, ses ignorances aussi et ses lacunes. Penser en tout et pour tout comme lui, avec lui, c’est se condamner infailliblement a l’erreur.
Alors il ne faut pas lire de journaux ? lance Charles Le Goffic. Il faut lire les journaux, mais il faut les contrôler les uns par les autres. Il n’y a pas de journal « sûr » et il ne peut pas y en avoir. « C’est pour avoir exigé de leurs journaux qu’ils soient sûrs, n’hésite pas à déclarer Fonsegrive, c’est-à-dire qu’on puisse les lire sans critique et sans défiance, presque en sommeillant, que les catholiques leur ont enlevé a peu prés tout piquant et tout intérêt. »
Prenons les journaux, même les meilleurs, pour ce qu’ils sont, pour les reflets momentanés de la vie publique dans des cerveaux obligés de se faire une opinion immédiate et de juger sur l’heure sans supplément d’information ; n’exigeons pas d’eux ce qu’ils ne peuvent pas nous donner ; accordons-leur la permission de se tromper et veillons seulement à ce qu’ils ne nous trompent pas. En d’autres termes, prenons-les pour auxiliaires ; ne les acceptons pas pour maîtres.
Il n’y a qu’à souscrire à ces excellents conseils, renchérit notre critique. Ils émanent, je le répète, d’un homme qui a beaucoup lu, beaucoup réfléchi, dont les idées ne sont point celles de tout le monde ni même celles de cette revue, mais qui n’a jamais aliéné son indépendance d’esprit et qui sait la garder vis-à-vis de ses amis comme de ses adversaires. J’ajoute, écrit encore Le Goffic, que le livre de M. Fonsegrive, si hardi, si courageux, est de la lecture la plus attrayante qui soit. L’auteur est un moraliste, mais sa morale n’a rien de revêche ; elle s’orne de toutes les grâces du style et s’aiguise au besoin d’une légère pointe d’humour. On ne le lit point qu’avec profit ; on prend plaisir à sa compagnie.

 Accueil
Accueil ACTUALITÉ
ACTUALITÉ

 DOSSIERS DU BAGNE DE GUYANE
DOSSIERS DU BAGNE DE GUYANE





